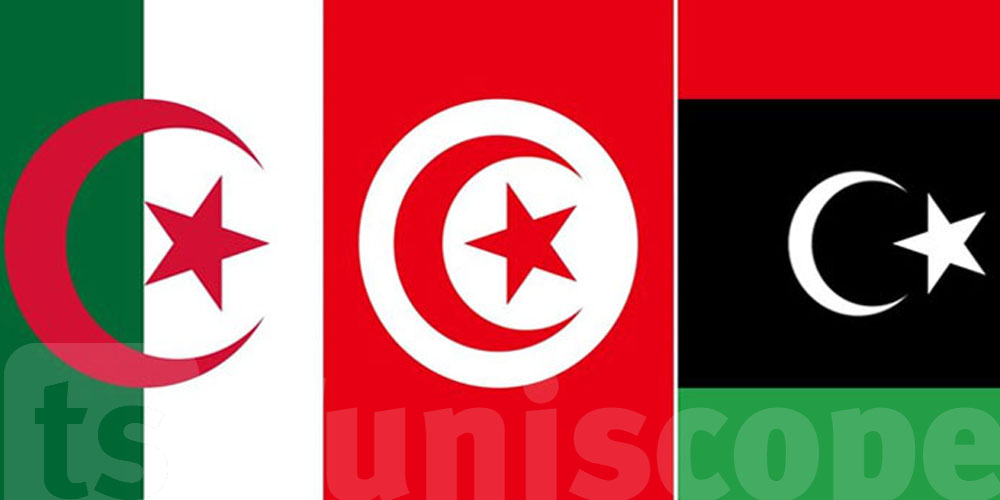Publié le 06-03-2018
Amnesty International publie une analyse : La Tunisie au-delà des apparences
Amnesty International vient de publier sur son siteweb une analyse de Thierry Brésillon à propos de la Tunisie.

Cette analyse dont ci joint une partie explique qu'en septembre 2011, à l’approche de l’élection de l’Assemblée constituante du 23 octobre, la section tunisienne d’Amnesty présentait un manifeste pour le changement en dix points. Une sorte de programme afin de rompre avec la dictature. Des propositions aussi élémentaires que l’interdiction de la détention au secret, la lutte contre la torture, la réforme de l’appareil sécuritaire, la lutte contre la violence faite aux femmes… A priori, l’aboutissement naturel de l’aspiration à la justice et à la liberté qui, quelques mois plus tôt, avait lancé des dizaines de milliers de Tunisiens dans la rue pour crier « Dégage ! » à Ben Ali et à tout ce qu’il représentait de corrompu, d’humiliant et de liberticide. Sur les quelque 160 partis existant alors, seule une trentaine avait signé ce manifeste. Peu de partis majeurs.
Et ni le Congrès pour la République (CPR) de Moncef Marzouki 1 (ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, aujourd’hui président de la République) ni Ettakatol (parti de centre gauche membre de l’Internationale socialiste) ni le parti islamiste Ennahdha, pourtant décidés à incarner la rupture avec l’ancien régime, n’avaient signé. En clair, aucun des partis de la coalition parvenue au pouvoir à l’issue des élections n’a voulu s’engager sur ce texte.
Où était le problème ? Est-ce l’abolition de la peine de mort ? Ou bien l’allusion implicite à l’égalité homme/femme dans l’héritage et à la dépénalisation de l’homosexualité sous-entendus dans le refus de toute discrimination ? Ou, de manière moins avouable, la volonté de ménager l’appareil sécuritaire, colonne vertébrale de l’ancien régime, à peine ébranlé par les bouleversements politiques ?
C’était un signe, en tout cas. Le directeur de la section tunisienne d’Amnesty, Lotfi Azzouz, le pressentait d’ailleurs, en avril 2011, quand il déclarait « Il faut s’attendre à voir à nouveau se poser la question de la spécificité culturelle face à l’universalisme ». Le débat n’a, en effet, pas manqué de se produire au sein de la commission chargée de rédiger le Préambule de la Constitution à l’Assemblée. Le projet de texte évoque « les nobles valeurs humaines », périphrase pour éviter l’expression « droits de l’Homme », et le terme « universel » a été jugé trop connoté aux valeurs occidentales.
Une société traumatisée
Les anciens opposants, dont le combat était animé par les références universelles, ont cru que la Révolution était leur victoire et qu’il leur appartenait d’écrire l’avenir. Au lendemain des élections remportées par Ennahdha, nombre d’entre eux devaient admettre qu’ils ne connaissaient pas la société tunisienne. L’élection de la Constituante a, en effet, donné une nette avance aux islamistes : 37 % pour Ennahdha, auxquels s’ajoutent 6,5 % pour les listes de la Pétition populaire – combinaison des réseaux locaux du RCD (l’ancien parti au pouvoir) et de conservatisme religieux – et plus de 8 % au CPR, dont une partie de la base électorale partage les valeurs des islamistes. Avec 125 000 voix, le Pôle démocrate moderniste pesait douze fois moins qu’Ennahdha.
Sans doute a-t-on projeté un peu trop vite nos espoirs sur la Tunisie de l’après Ben Ali sans réaliser que l’événement s’inscrivait dans le prolongement d’une Histoire, dans une société dont, il ne faut pas l’oublier, la propagande et la censure avaient précisément pour objectif de dissimuler la réalité. La fin de la dictature a levé le couvercle. L’image d’une Tunisie ouverte, accordant un statut d’avant-garde aux femmes, modernisée, laïque même, se révélait un trompe-l’oeil. C’était une vitrine, un capital politique destiné à légitimer un pouvoir aux mains de clans qui avaient parasité l’État pour vampiriser l’économie.
Les échecs de la modernisation
La société que l’on découvre est le produit des limites du projet d’Habib Bourguiba, le père de l’Indépendance, dont l’héritage moderniste a échoué sur deux points. Le premier est le rendez-vous manqué avec la démocratie. Son accession au pouvoir est marquée en particulier par la répression de l’opposition emmenée par Salah Ben Youssef en 1956, qui a tourné à la guerre civile et installé la torture au cœur du système de gouvernement. Dès 1966, Ahmed Tlili, l’une des grandes figures du mouvement national et syndical adressait une lettre au chef de l’État dans laquelle il plaidait pour la démocratisation et dénonçait déjà toutes les dérives : la dictature policière, la mise au pas de la société civile, l’accaparement de l’économie, la confiscation du pouvoir. La répression impitoyable qui a envoyé à la prison et à la torture 30 000 membres plus ou moins proches d’Ennahdha durant les années Ben Ali, et s’est employée à les briser socialement, a renforcé le traumatisme dans les mémoires familiales et collectives.
Le second échec de la modernisation est la marginalisation des régions intérieures au profit de la côte, seule réelle bénéficiaire, créant un décalage sociologique et culturel croissant.
Ben Ali, en prenant le pouvoir le 7 novembre 1987, a remplacé la symbolique de « l’Indépendance », par celle du « changement » – formule incantatoire rapidement vidée de tout contenu –, tout en se revendiquant de l’héritage modernisateur de Bourguiba ; de son côté, Leïla Trabelsi, son épouse, vantait les vertus du féminisme. Alors que dans la réalité, l’inégalité régionale et la censure enclavaient la majorité de la population dans ses archaïsmes et la médiocrité culturelle.
L’effet le plus pervers de ces décennies de dictature est d’avoir associé la modernisation, le rapprochement avec l’Europe, le féminisme, à la répression et à la corruption morale du régime. Ce n’est pas le terreau le plus propice à l’épanouissement de la culture des droits humains. D’autant que, pour compenser l’épuisement du mythe du « changement », Ben Ali a largement instrumentalisé la religion pour tenter d’en tirer un surcroît de légitimité, et ouvert la porte aux prédicateurs étrangers les plus rétrogrades. En revanche, la censure interdisait l’entrée en Tunisie de la littérature produite par les cadres en exil d’Ennahdha, témoignant de l’évolution de l’islam politique pour intégrer la question de l’État, du pluralisme et des droits dans les références religieuses. Le « rempart contre l’islamisme » a donc plutôt préparé le terrain de la radicalisation.
Si le débat public post-dictature, autour du droit des femmes, de la liberté d’expression, de la place de l’universalisme… donne l’apparence d’une régression, il s’agit plutôt d’un retour du refoulé. D’une résurgence de tout ce que le discours officiel a figé dans la raideur d’un dogme de plus en plus en décalage avec la réalité sociale.
Réformisme musulman
Mais ces questionnements structurent la vie intellectuelle et politique tunisienne depuis la moitié du XIXe siècle, quand l’Empire ottoman, maître de la Tunisie, était confronté à la puissance impériale européenne et cherchait à l’égaler sans renoncer aux références islamiques. Cette préoccupation avait donné naissance au réformisme musulman incarné en Tunisie dans l’entreprise des beys représentant l’autorité de la Sublime Porte : Ahmed Bey au pouvoir de 1837 à 1855 qui a aboli l’esclavage en 1846, ou encore Kheireddine Pacha (1873-1877) dotant la Tunisie d’institutions modernes. Ils se sont heurtés à leur époque aux conservatismes qui refusaient toute ouverture aux idées extérieures.
Bourguiba avait prolongé cette œuvre, en verrouillant le débat. Aujourd’hui, les verrous ont sauté et, dans le chaos d’un bouleversement politique, les Tunisiens ont la possibilité de le reprendre pour réinventer leur propre synthèse.